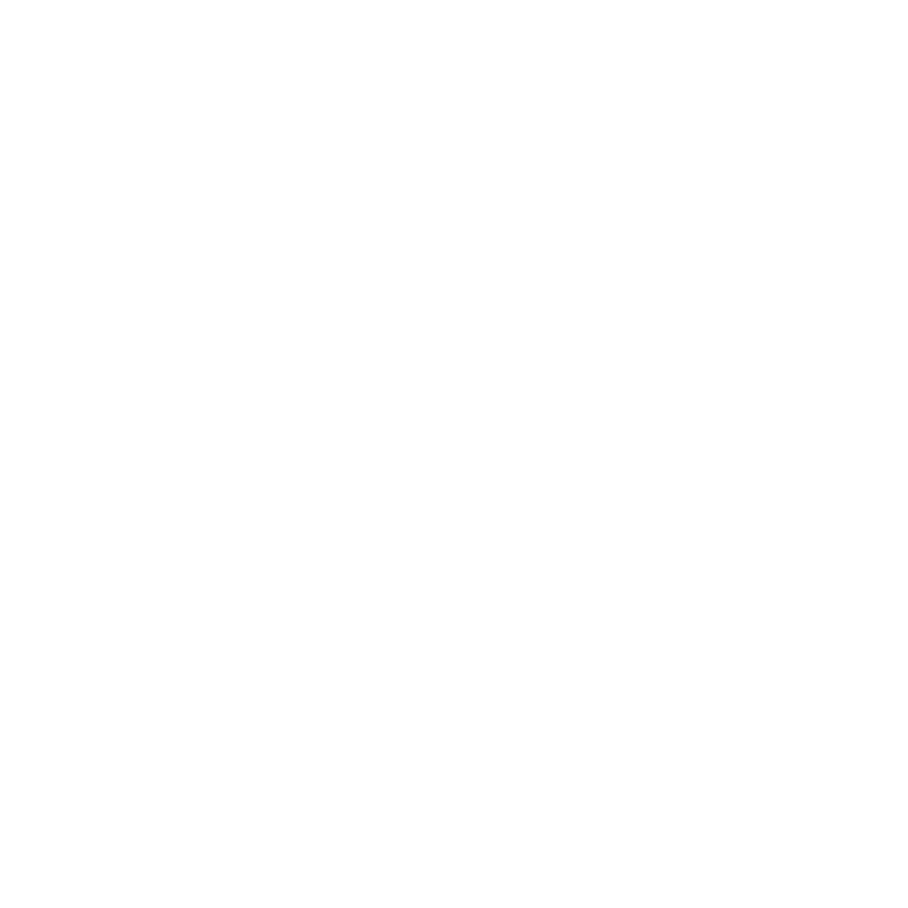Une réforme de grande ampleur revoit les causes de nullités des sociétés et leur régime tout en offrant un large pouvoir d’appréciation au juge chargé de se prononcer sur l’existence ou non d’une nullité et de ses effets potentiels.
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 met en place un nouveau régime des nullités en droit des sociétés [1].
Une réforme très attendue
En juin 2024, le législateur a habilité le Gouvernement à réformer le régime des nullités en droit des sociétés [2]. Cette réforme était très attendue par les professionnels du droit. En effet, le régime nullités en matière de droit des sociétés présentait de nombreuses redites et incohérences. Sa complexité et certaines de ses lacunes étaient source d’insécurité juridique pour les entreprises et leurs contractants. Un rapport du Haut comité juridique de la place financière de Paris , ainsi que les recommandations du Conseil d’État [3] ont abondé dans ce sens. La réforme a cependant tardé à être mise en œuvre. Ce n’est qu’en mars 2025, près de neuf mois plus tard, que l’ordonnance entérinant ces nouvelles règles a été publiée. Elle met en place une réforme de grande ampleur, destinée à moderniser le droit des nullités.
Une volonté de clarification et de modernisation
L’ordonnance est structurée en trois titres. Le premier est relatif au régime de nullités des sociétés dans le Code civil, le second à celui du Code de commerce et le dernier titre à des mesures diverses. Désormais, le régime de droit commun des nullités en matière de droit des sociétés figure exclusivement dans le Code Civil. L’ordonnance harmonise le droit interne avec les textes communautaires [5] et prévoit des critères plus stricts pour la reconnaissance des nullités tout en limitant leur portée.
Des causes de nullité revues et corrigées
L’ordonnance revoit l’ensemble des causes de nullités et encadre les conditions dans lesquelles la nullité des sociétés et des décisions sociales peut être prononcée par le juge. Les causes de nullité des sociétés sont désormais limitées au seul cas de l’incapacité des fondateurs et de la violation de la règle relative au nombre minimum d’associés. La violation des règles du droit commun des contrats et l’illicéité de l’objet social ne sont plus susceptibles de constituer une cause de nullité.
L’Ordonnance précise que les clauses statutaires contraires à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société sont réputées non écrites (article 1844-10-4 du Code civil). Il s’agit de la transposition de la jurisprudence Larzul 1 de 2010 [6].
Enfin, un nouvel article 1844-10-1 du Code civil clarifie le régime de la nullité de l’apport, distinct de la nullité de la société. La nullité de l’apport entraîne l’annulation des parts sociales ou des actions émises en contrepartie. Elle provoque également la restitution, par la société, des engagements exécutés par l’apporteur.
La méconnaissance d’une disposition impérative ou d’une cause générale de nullité des contrats est en outre susceptible de remettre en cause une augmentation de capital.
De nouvelles sources de nullités potentielles
Le texte substitue en outre la notion de « décision sociale » à celle d’ « actes ou de délibérations de la société ». Cette définition plus restreinte du périmètre du nouveau régime des nullités est un facteur de sécurité juridique. Ainsi les contrats signés avec des tiers ou les avis émis par des instances collectives non décisionnaires n’entrent pas dans ce périmètre.
Désormais la nullité d’une décision sociale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du Code civil, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. De façon surprenante, cette précision étend le champ des nullités sans le rattacher à un corpus précis de dispositions textuelles (nullités textuelles). De nombreux textes réglementaires sont donc susceptibles d’être invoqués (nullités virtuelles) alors même qu’ils ne constituent pas des règles impératives. Cette réouverture très large du champ des nullités constitue un facteur d’insécurité juridique certain. En outre, elle apparaît en décalage avec l’objectif de l’ordonnance de réduire les causes de nullités.
Enfin l’ordonnance clarifie le régime de nullité en cas de violation des statuts. La violation des statuts ne constitue désormais pas une cause de nullité sauf si la loi en dispose autrement. Cependant, dans les SAS, il est possible de prévoir statutairement la nullité des décisions sociales prises en violation des statuts. Ce texte, qui revient sur la jurisprudence Larzul 2 [7], est donc susceptible de créer une inégalité juridique entre les SAS qui auront su adapter leurs statuts à la réforme et les autres.
Un triple test nécessaire pour juger de la nullité
Par exception, la nullité automatique est maintenue dans certains cas. Mais en principe, désormais, le juge saisi d’une demande de nullité d’une décision sociale, ne peut prononcer cette nullité que si trois conditions sont réunies. Ce triple test est codifié dans le nouvel article 1844-12-1 du Code civil prévoyant des directives d’interprétation pour le juge :
– le demandeur doit prouver l’existence d’un grief,
– l’irrégularité invoquée doit avoir eu une incidence sur le sens de la décision contestée,
– les effets de la nullité ne doivent pas être disproportionnés pour l’intérêt social au regard de l’atteinte subie.
Comme par le passé, le juge ne peut prononcer la nullité si la cause de celle-ci a disparu au moment où le juge statue sur le fond en première instance (article 1844-11 du Code civil). Il peut également accorder à la société un délai pour couvrir la nullité (article 1844-11 du Code civil).
Sécurité juridique renforcée et prescription raccourcie
Autre facteur de sécurité juridique, le délai de prescription des actions en nullité de la société, d’apport ou de décisions sociales postérieures est raccourci, passant de trois ans à deux ans (article 1844-14 du Code civil). En revanche, les dispositions relatives à la prescription propres aux modifications du capital social, aux fusions et aux scissions restent inchangées.
Le juge peut en outre moduler dans le temps les effets de la nullité lorsqu’elle pourrait avoir des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social. Concrètement cette disposition d’ordre général (article 1844-15-2 du Code civil) permet donc au juge de priver la nullité de son effet rétroactif.
En évitant les nullités en cascade qui viennent fragiliser le quotidien des entreprises, ce texte a également pour mérite de renforcer la sécurité juridique des acteurs économiques. Ainsi sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe ou d’un membre d’un organe de la société n’entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci (article 1844-15-1 du Code civil). Ce texte généralise une règle qui n’existait jusqu’ici que pour les SA.
Les effets de la nullité
Lorsque la nullité de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation. L’ordonnance ne modifie pas le régime des effets de la nullité sur les tiers. Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. En revanche, si la nullité résulte de l’incapacité ou d’un vice du consentement, elle est opposable aux tiers par l’incapable et ses représentants légaux, ou par l’associé dont le consentement a été vicié.
La prescription des actions en responsabilité (article 1844-17 du Code civil) fondées sur l’annulation de la société ou des décisions sociales et apports postérieurs est fixée à trois ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée. L’action en dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le vice affectant la société, la décision sociale ou l’apport peut prospérer même si la cause de nullité a disparu. Son délai de prescription est de trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
Une réforme ambitieuse mais inachevée ?
La grande majorité des praticiens du droit saluent l’objectif de clarification et de modernisation poursuivie par la réforme des nullités. Ils sont également nombreux à juger ce texte particulièrement ambitieux. Le droit des nullités résultait d’un enchevêtrement de dispositions, certaines obsolètes, d’autres redondantes, voire contradictoires. La réforme est donc bienvenue. Cependant nombre d’auteurs s’alarment de voir se créer de nouvelles sources de nullité pour les SAS et les décisions sociales. Surtout, la généralisation du caractère facultatif des nullités avec l’instauration du triple test concentre les inquiétudes. La possibilité offerte au juge de moduler les effets des nullités, le mécanisme visant les nullités en cascade et la suppression des nullités d’augmentations de capital dans les sociétés cotées inquiètent également les commentateurs.
[1] Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, JORF n°0062 du 13 mars 2025
[2] La loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, JORF n°0138 du 14 juin 2024
[3] Haut comité juridique de la place financière de Paris, Rapport sur les nullités en droit des sociétés, 27 mars 2020, //www.hcjp.fr/fr/droit-des-societes
[4] Conseil d’État, Simplification, Nullités en droit des sociétés, 4 juillet 2024
[5] Directive (UE) 2017/1132 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017, JOUE 30/06/2017, L 169/46
[6] Cass. Com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Larzul 1
[7] Cass. Com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Larzul 2